Femmes de lettres
Catégories
-

Tempérament passionné (1), énergique, volontaire et quelque peu pénible, sans doute... Mais certainement des idées nouvelles en son temps. En tout cas, une véritable femme de lettres ! Et même si elle constate en 1800 : « Ce qu'on appelait un homme de lettres n'existe plus en France, il n'y a plus de profession à part. » Elle entend par là que la République des Lettres, étendue à toute la nation lors la Révolution (tout le monde prend la plume) soumet les écrivains à la politique : écrire, c'est vouloir refaire le monde et risquer sa tête. Napoléon (son grand ennemi pourtant) affirmera de même : « La tragédie aujourd'hui, c'est la politique. »
Mme de Staël est l'une des premières femmes à oser signer de son nom, se proclamant ainsi auteur, assumant ses choix politiques et intellectuels. On peut l'aimer ou non, mais nul ne saurait lui dénier l'intelligence.
Schiller écrivait d'elle : « Elle veut tout expliquer, pénétrer, mesurer ; elle n'admet rien d'obscur, rien d'inaccessible, et, dans les régions qu'elle ne peut éclairer de son flambeau, il n'existe rien pour elle. »
Elle annonce le romantisme et le sentiment de l'infini : « Ces limites qui resserrent douloureusement notre cœur, une émotion vague, un sentiment élevé les fait oublier pendant quelques instants. » Et on lui doit sans doute la première définition du romantisme : « Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie dont les chants des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. » (De l'Allemagne).
À propos de son ouvrage De l'Allemagne, Goethe dira : « De l'Allemagne fut comme un puissant instrument qui fit la première brèche dans la muraille d'antiques préjugés élevée entre nous et la France. »
Et Sainte-Beuve : « Je ne crois pas qu'il y ait encore à chercher ailleurs la vive image de cette éclosion du génie allemand, le tableau de cet âge brillant et poétique qu'on peut appeler le siècle de Goethe. »
On peut également avancer qu'elle ouvre la voie à la critique littéraire avec son autre ouvrage De la Littérature, où elle tient compte de l'Histoire dans l'appréciation des œuvres (cf. la Querelle des Anciens et des Modernes à la fin du 17e siècle qui remet en question la doctrine du classicisme et relativise les critères du jugement esthétique).
Elle apprécie Rousseau dont elle dit : "J.-J. Rousseau n'a rien découvert, mais il a tout enflammé".
_ _ _
Notes
(1) Elle parle toute jeune encore du « ridicule que les âmes froides donnent aux âmes ardentes. Ils appellent exagéré tout ce qu'ils ne sentent pas et disent qu'on est monté sur des échasses alors qu'on est plus grand qu'eux. » Mme de Staël ne négligera jamais un certain pathos...
Remarques
Pouvait-on évoquer le 18e siècle en omettant Mme de Staël, née en 1766, témoin de l'Ancien Régime, de ses dernières convulsions, et qui ouvre la porte au 19e siècle, tout comme Chateaubriand ? Et tous deux, écrivains cosmopolites, ont ouvert dans une certaine mesure la porte à la littérature comparée. Mme de Staël voyage, s'enthousiasme, découvre, analyse les mœurs et la littérature allemandes et les compare avec les nôtres.
Par ailleurs, on peut lui accorder une certaine vision prémonitoire à propos des femmes : « Il arrivera, je le crois, une époque quelconque, où des législateurs philosophes donneront une attention sérieuse à l’éducation que les femmes doivent recevoir, aux lois civiles qui les protègent, aux devoirs qu’il faut leur imposer, au bonheur qui peut leur être garanti ; mais dans l’état actuel, elles ne sont, pour la plupart, ni dans l’ordre de la nature, ni dans l’ordre de la société. Ce qui réussit aux unes perd les autres ; les qualités leur nuisent quelquefois, quelquefois leurs défauts les servent ; tantôt elles sont tout, tantôt elles ne sont rien. Leur destinée ressemble, à quelques égards, à celle des affranchis chez les empereurs : si elles veulent acquérir de l’ascendant, on leur fait un crime d’un pouvoir que les lois ne leur ont pas donné ; si elles restent esclaves, on opprime leur destinée... » (De la Littérature).
Pour ces lignes, nous lui pardonnerons le reste...
Additif :
C'est Mme de Staël qui, la première, fait la distinction entre bêtise et sottise : "La bêtise et la sottise diffèrent essentiellement en ceci, que les bêtes se soumettent volontiers à la nature, et que les sots se flattent toujours de dominer la société." Ce que semble confirmer Baudelaire qui écrit en 1846 : "La grande poésie est essentiellement bête, elle croit, et c'est ce qui fait sa gloire et sa force." Et Flaubert en 1852 : "Les chefs- d'oeuvre sont bêtes. - Ils ont la mine tranquille comme les productions mêmes de la nature, comme les grands animaux et les montagnes."
Toujours selon Baudelaire, l'art est assimilable à la femme : "Il y a des gens qui rougissent d'avoir aimé une femme, le jours qu'ils s'aperçoivent qu'elle est bête." Baudelaire proteste : "La bêtise est souvent l'ornement de la beauté ; c'est elle qui donne aux yeux cette limpidité morne des étangs noirâtres, et ce calme huileux des mers tropicales."
* * *
-

Salonnière quasiment aveugle à la fin de sa vie, tombée amoureuse dans un âge fort avancé du jeune Horace Walpole, Mme du Deffand était la tante de Julie de Lespinasse.
Son salon de la rue Saint-Dominique était couru du tout-Paris. Elle ne publia rien mais nous disposons de sa volumineuse correspondance (notamment ses lettres à Voltaire) dont Sainte-Beuve a dit dans ses Causeries du lundi : « Elle est, avec Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette époque, sans même en excepter aucun des grands écrivains. »
« Vaporeuse » (autrement dit dépressive), elle voyait le monde avec une grande lucidité non dépourvue de pessimisme. Son jugement sur les uns et les autres était particulièrement tranchant. Revenue de tout, elle considérait que l'humanité ne comprenait que « trompeurs, trompés et trompettes. » Pour « tolérer la vie », elle s’adonnait à l’opium. Elle écrit dans la lettre à Horace Walpole du 20 octobre 1766 : « J'admirais hier au soir la nombreuse compagnie qui était chez moi, hommes et femmes me paraissaient des machines à ressort, qui allaient, venaient, parlaient, riaient, sans penser, sans réfléchir, sans sentir ; chacun jouait son rôle par habitude… et moi j'étais abîmée dans les réflexions les plus noires ; je pensais que j'avais passé ma vie dans les illusions ; que je m'étais creusé moi-même tous les abîmes dans lesquels j'étais tombée. »
Mais elle ne dénigre pas pour autant les plaisirs de la table. Dans une de ses lettres, elle décrit l'ordinaire de ses repas lors d'un séjour chez une amie à la campagne : « un bon potage de riz, des figues et des petits raves, des saucisses, des filets de mouton à la provençale, une poularde en fricandeau, un gigot de mouton à l'estouffade avec des épinards, une rognonnade de mouton et un morceau de bœuf, des perdreaux rouges et deux plats d'entremets. »
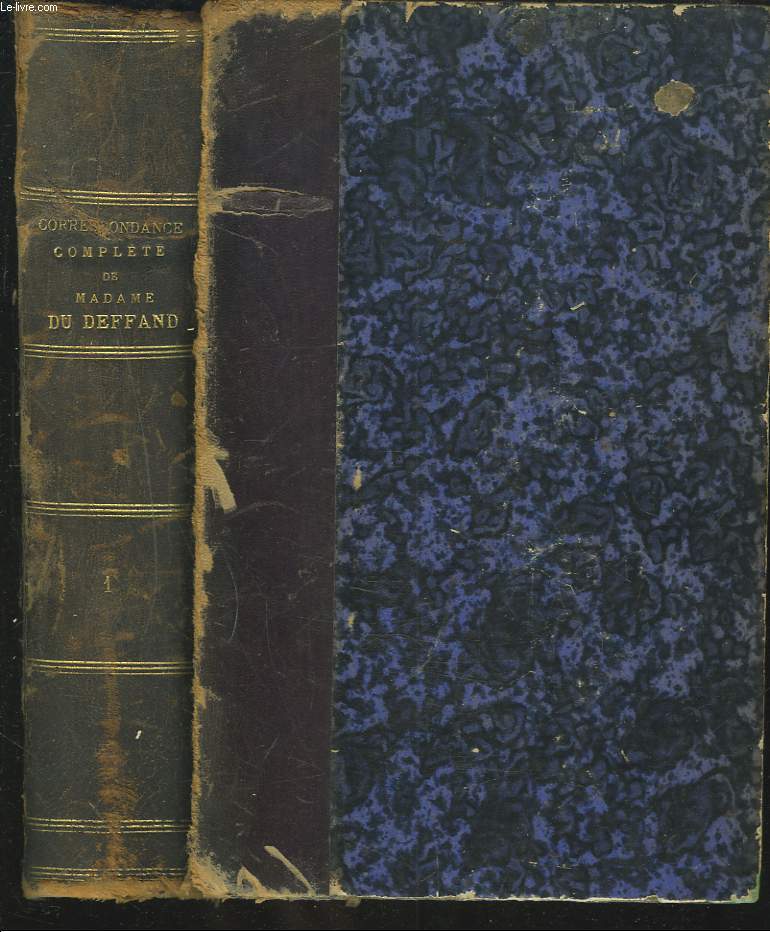 Madame du Deffand n'a rien publié mais sa Correspondance avec, entre autres, Voltaire et Horace Walpole révèle son esprit indépendant et sceptique, et constitue un document intéressant sur l'histoire de la société du 18e siècle. À ce titre, c'est une véritable femme de lettres, dans le sens premier du terme.Trois recueils de Lettres de Mme du Deffand paraissent à Paris en 1809 (correspondance avec Voltaire, le président Hénault, Turgot, d’Alembert et les autres Encyclopédistes), à Londres en 1810 (correspondance avec la duchesse de Choiseul) et à Paris en 1859 (correspondance avec Horace Walpole). La première édition complète date de 1865.
Madame du Deffand n'a rien publié mais sa Correspondance avec, entre autres, Voltaire et Horace Walpole révèle son esprit indépendant et sceptique, et constitue un document intéressant sur l'histoire de la société du 18e siècle. À ce titre, c'est une véritable femme de lettres, dans le sens premier du terme.Trois recueils de Lettres de Mme du Deffand paraissent à Paris en 1809 (correspondance avec Voltaire, le président Hénault, Turgot, d’Alembert et les autres Encyclopédistes), à Londres en 1810 (correspondance avec la duchesse de Choiseul) et à Paris en 1859 (correspondance avec Horace Walpole). La première édition complète date de 1865.Une phrase à retenir : « Allez, allez, il n'y a que les passions qui fassent penser. »
Et cette réflexion : « Ah ! la raison, la raison ! qu'est-ce que c'est que la raison ? quel pouvoir a-t-elle ? quand est-ce qu'elle parle ? quand est-ce qu'on peut l'écouter ? quel bien procure-t-elle ? Elle triomphe des passions ? Cela n'est pas vrai ; et si elle arrêtait les mouvements de notre âme, elle serait cent fois plus contraire à notre bonheur que les passions ne peuvent l'être ; ce serait vivre pour sentir le néant, et le néant (dont je fais grand cas) n'est bon que parce qu'on ne le sent pas. »
Remarque
La correspondance de Mme du Deffand, rééditée aujourd'hui, est la source de nos articles, sauf exception.
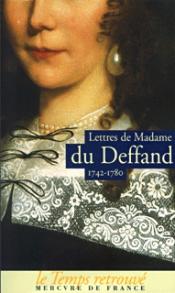
* * *
-

Femme légère dans sa jeunesse, Mme de Genlis devint une femme de lettres, écrivit des biographies, des romans, des pièces, des discours et quantité d'ouvrages d'éducation, au total plus de 80 volumes. Ses romans sont largement illisibles de nos jours. On peut citer Les Chevaliers du Cygne (1795) : sous les noms de Hunaud d'Aquitaine, Iliska et la reine Edburge, on reconnaît Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre et bien d'autres ; sous le couvert d'une histoire de la guerre de Charlemagne contre les Saxons, Mme de Genlis dénonce les causes de la Révolution, et ses excès et propose l'idéal d'une monarchie libérale et représentative.
Elle fut la « gouverneuse » des enfants du duc d'Orléans et laissa des Mémoires intéressants pour ce qui est de la vie quotidienne au 18e siècle, tant à la cour qu'à la ville, selon l'expression du temps. Toutefois, il convient d'en relativiser certains propos, ou du moins de les mettre en perspective.
Elle finit dans la pauvreté, continuant toujours à écrire, recevant de nombreux visiteurs curieux des manières de vivre sous l'Ancien Régime. Sa tante, Mme de Montesson, brilla sous le Consulat et l'Empire, donnant des leçons de savoir-vivre à la nouvelle cour.
On peut évoquer une anecdote à son égard, très représentative de ce savoir-vivre de l'Ancien Régime et qui n'a que faire des conditions matérielles. En 1823, deux ans avant la publication des Mémoires de Mme de Genlis chez Ladvocat, Barrière (1) rendit visite à la romancière en compagnie d’une nièce : « Nous la trouvâmes à la place Royale, au premier, mais dans un appartement de bien médiocre apparence et surtout bien mal tenu. Mme de Genlis était assise devant une table de bois de pin, noircie par le temps et l’usage. Cette table offrait le bizarre assemblage d’une foule d’objets en désordre ; on y voyait pêle-mêle des brosses à dents, un tour de cheveux, deux pots de confiture entamés, des coquilles d’œufs, des peignes, un petit pain, de la pommade, un demi-rouleau de sirop de capillaire, un reste de café au lait dans une tasse ébréchée, des fers propres à gaufrer des fleurs en papier, un bout de chandelle, une guirlande commencée à l’aquarelle, un peu de fromage de Brie, un encrier de plomb, deux volumes bien gras et deux carrés de papier sur lesquels étaient griffonnés des vers. Elle ne nous reçut pas moins avec le ton, l’aisance la parfaite amabilité d’une femme du grand monde. »
A propos de l'intérêt de ses Mémoires
Mme de Genlis publie ses Mémoires en 1825, achevant ainsi le travail d’une écrivaine ayant traversé l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire et la Restauration. L’œuvre est mal accueillie par ses proches – elle dévoile des secrets de famille -, critiquée par les adversaires de la royauté – elle porte sur l’Ancien Régime un regard nostalgique -, elle défraie la chronique journalistique et suscite maintes polémiques.
Les Mémoires offrent cependant un plus grand intérêt que son œuvre immense et prolixe : musicienne, peintre, romancière à succès dans le genre sentimental ou gothique (comme Ann Radcliffe), auteur de pièces de théâtre destinées aux enfants, éducatrice et pédagogue passionnée, mais aussi grande mondaine, connaissant les pratiques salonnières, l’art de la conversation et les usages de la bonne société, Mme de Genlis incarne la femme cultivée de la seconde moitié du 18e siècle.
Cette activité frénétique et dévorante peut déconcerter le lecteur contemporain. On a relevé des contradictions : séductrice et bas-bleu, apôtre de la vertu et implacable intrigante, intellectuelle et frivole. Elle se pose en protectrice de la religion, s’oppose donc à Voltaire ou Diderot, mais adopte les positions philosophiques du clan orléaniste et contemple avec joie la Bastille que l’on détruit.
Il ne s’agit pas ici de porter un jugement moral mais de lire les Mémoires comme un témoignage authentique des pratiques sociales et des mœurs d’une partie de la société aristocratique à la veille de la Révolution : l’intérêt documentaire est immense. Les Goncourt ne s’y sont pas trompés : ils y ont puisé d’innombrables informations pour leur ouvrage La femme au XVIIIe siècle. (Mémoires de Mme de Genlis, Mercure de France, 2004, présentation de Didier Masseau).
_ _ _
Notes
(1) Barrière établira une édition des Mémoires de Mme de Genlis, parus chez Firmin Didot Frères en 1857.
* * *
